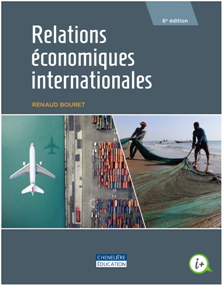
Le tournant néolibéral des années 1980 s’est accompagné, en Occident, de privatisations, de politiques d’austérité et d’une mondialisation industrielle et financière. Les fleurons économiques nationaux étaient vendus aux plus offrants, et les sociétés transnationales délocalisaient leur production. Les politiques budgétaires de relance, en vogue depuis les années 1930, étaient renvoyées aux oubliettes, avec une brève parenthèse, vite refermée, face à la catastrophe financière de 2008. Le Traité de Maastricht (1992), pivot de ce néolibéralisme en Europe, limitait les déficits publics de ses membres à 3 % du PIB, voire moins pour certains « privilégiés ».
Dans les premiers mois de 2020, la mise en quarantaine de plusieurs milliards de Terriens fait reculer la production mondiale dans des proportions inédites. Certains gouvernements, qui ont tardé à réagir devant l’épidémie imminente et inéluctable du nouveau coronavirus, redoublent de zèle pour se refaire une vertu. Les subventions aux ménages et aux entreprises se mettent à pleuvoir, et les déficits publics explosent. Le plafond de 3 % est allègrement crevé pour devoir dépasser les 10 % dans bon nombre de pays. Le fait que des décennies de néolibéralisme aient affaibli les systèmes collectifs de santé, et que la mondialisation ait fragilisé l’accès à de nombreux biens de première nécessité, ajoute à l’urgence.
Il faut bien sûr parer aux besoins les plus pressants, mais ce recours à la « planche à billets » est-il tenable au-delà de quelques semaines? Ne risque-t-il pas, dans les circonstances, de déboucher sur une hyperinflation ou une crise financière majeure? Que se passerait-il si les citoyens, aussi terrorisés qu’ils étaient d’abord insouciants, refusaient de renvoyer leurs enfants à l’école ou de retourner au travail?
À situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Plutôt que risquer leur vie en mettant le nez dehors, les citoyens demandent à l’État de s’endetter, voire de créer la monnaie nécessaire au financement de leurs besoins essentiels. Ce qui compte avant tout, ce n’est pas de produire les biens, mais de fournir aux ménages le pouvoir d’achat qui leur permettrait de les acheter. On a vaguement conscience que les biens que l’on consomme doivent préalablement être produits, mais on dispose d’une solution miracle : il suffira d’importer davantage. On se doute bien, par ailleurs, que nos partenaires commerciaux sont dans le même pétrin que nous, mais on préfère ne pas y penser.
Une fois encore, les généraux sont en retard d’une guerre. Les crises économiques, comme les épidémies, exigent des remèdes adaptés à leurs causes. On ne soigne pas la peste de la même façon que le choléra. Les politiques budgétaires keynésiennes, basées sur un accroissement des déficits publics, ont pour but de contrecarrer une crise de la demande. Il y a alors trop de produits sur le marché et pas assez d’acheteurs. L’endettement accru de l’État permet, à point nommé, d’éponger le trop-plein d’épargne du secteur privé.
Une telle politique de relance ne fonctionne pas dans toutes les circonstances. Elle ne convient pas, notamment, lors d’une crise de l’offre, qui prend sa source, non pas dans un recul de la demande, mais dans une montée des coûts de production. Les politiques keynésiennes mises en place lors de la crise du pétrole (1975) se sont principalement traduites par une envolée de l’inflation. Cet échec inévitable, puisque le remède n’était pas adapté à la maladie, a d’ailleurs opportunément préparé le terrain à l’ère de néolibéralisme qui a suivi.
Les dépenses massives engagées par les États à partir d’avril 2020 fournissent un filet de sécurité temporaire aux citoyens qui se retrouvent sans revenus, et aux entreprises menacées de faillite. Cependant, elles ne peuvent à elles seules enrayer la crise économique inédite que nous connaissons actuellement. Lors d’une crise de surproduction, comme celle des années 1930, les déficits publics permettent d’accomplir des merveilles. Or, nous nous dirigeons au contraire, si la fermeture de l’économie se prolonge de façon excessive, vers une crise de sous-production, accompagnée de pénuries croissantes et d’une dégringolade des recettes fiscales. Sans un redémarrage programmé des entreprises, les généreuses politiques budgétaires de nos gouvernements ne peuvent que déboucher sur une flambée d’inflation, qui aura tôt fait de dégonfler les porte-monnaie, et à des déficits records.
Il ne faut pas oublier non plus que l’explosion de la dette publique pèsera lourdement sur les finances de l’État. Tôt ou tard, quelqu’un devra payer la note, sous forme de hausse d’impôts, de baisse des services ou de dévalorisation de l’épargne. Si le dogme de l’austérité a longtemps nui à la croissance économique, la perte de maîtrise de la dette publique amène également son cortège de désagréments.
Il ne faudra pas pour autant serrer la vis de façon prématurée : la récession laissera sur le carreau un certain nombre de travailleurs et d’entreprises, qu’un simple soutien financier ne suffira pas à remettre en selle. Le retour à la normale ne pourra s’accomplir sans des politiques industrielles à plus long terme. Ce sera l’occasion, pour les différents pays, après 40 ans de néolibéralisme et de mondialisation effrénée, de renforcer leur autosuffisance et de réduire leur vulnérabilité face aux crises inévitables de ce monde.
Comme cela est souvent le cas dans l’histoire, nous nous trouvons aujourd’hui devant un dilemme. Il s’agit d’arbitrer entre sécurité sanitaire et sécurité matérielle, le renforcement de l’une des deux options se faisant nécessairement au détriment de l’autre.
Renaud Bouret
26 avril 2020